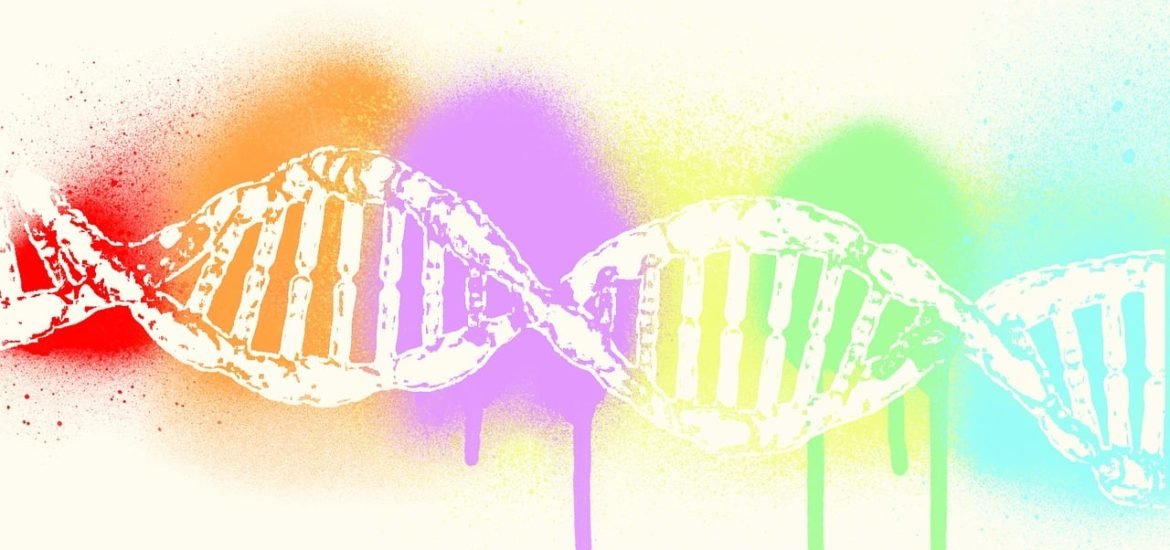
En 2022, à La Sorbonne, s’est tenu le colloque « Après la déconstruction: reconstruire les sciences et la culture » organisé conjointement par l’Observatoire du décolonialisme, le Collège de Philosophie et le Comité Laïcité-République. Parmi les participants de nombreuses célébrités Pascal Bruckner, Mathieu Bock-Côté, Pierre Jourde, Pierre Vermeren, Christophe de Voogd, Nathalie Heinich, Dominique Schnapper, Pascal Perrineau et Bernard Rougier, Pierre-André Taguieff, Florence Bergeaud-Blackler, Philippe d’Iribarne, Claude Habib et Catherine Kintzler, Anne-Marie Le Pourhiet… Essayistes médiatiques, historiens, philosophes, sociologues, anthropologues, politologues… les grandes figures des sciences humaines s’étaient données rendez-vous pour analyser sous toutes ses coutures l’épidémie de wokisme qui frappe tout le milieu universitaire sans exception…
Parmi elles également le biologiste de renommée internationale Marcel Kuntz, directeur de recherche au CNRS, enseignant et auteur pour European Scientist était également présent pour parler des ravages du wokisme dans les sciences dures. C’est de la participation à cet événement qu’est née chez l’auteur cette idée forte utile : rédiger un abécédaire du wokisme. Paru chez VA éditions en Mai 2023, « De la déconstruction du wokisme, la science menacée » (préface de Chantal Delsol) est donc un petit format fait de 25 entrées thématiques. On y retrouve des thèmes tels que « Annulation », « Culpabilisation », « Déconstruction », « Ecologisme » …. De la même manière qu’il dissèque les molécules d’ADN dans son laboratoire, Marcel Kuntz, déconstruit méthodiquement l’ADN du wokisme. Pour vous donner envie de lire cet ouvrage European Scientist a sélectionné trois lettres en rapport avec la politique scientifique. K. pour « Kuhn », P pour « Postmodernité » et R pou « Relativisme ».
A l’occasion de l’été European Scientist diffuse les bonnes feuilles d’ouvrages en lien avec la politique scientifique.
K. Kuhn, Thomas (18 juillet 1922 – 17 juin 1996), philosophe américain
Le concept de « changement de paradigme » proposé par Thomas Kuhn (La Structure des révolutions scientifiques, 1962) a fourni des justifications aux critiques postmodernes de la science et notamment de sa « prétention » à comprendre la réalité. En effet, si la science ne progresse pas selon un processus continu d’accumulation de connaissances, mais plutôt par de soudaines « révolutions » (changements de paradigmes), alors la confiance en l’objectivité de la « science normale » s’érode. Kuhn n’a sans doute pas souhaité remettre en cause la capacité de la science à accumuler des connaissances et s’est défendu de tout relativisme (La tension essentielle, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, 1990).
Cependant, selon lui, outre le paradigme du moment et les critères, en apparence objectifs, qui aident à déterminer le choix d’une théorie, les jugements des scientifiques peuvent être influencés par des facteurs comme leur histoire individuelle, ce qui fournit des arguments au constructivisme (voir l’entrée « x-studies* »). Pour Jean-François Braunstein (La Religion Woke, Grasset, 2022), ce sont les interprétations de La Structure des révolutions scientifiques de Kuhn, et non pas les auteurs de la French Theory* comme Foucault, qui ont influencé la vision postmoderne* de la dimension sociale et culturelle des changements de paradigme en science.
En tout état de cause, les théories de Kuhn et leurs interprétations ont acquis une influence considérable dans un contexte où les conceptions du politique et du social ont été fortement remises en cause dans le monde occidental.
P. Postmodernisme, postmodernité
Le postmodernisme peut être défini comme le rejet des « méta-récits » du développement humain biologique, historique ou social (Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, 1979), comme la religion, la science, la famille, etc. Ces « grands récits » seraient pernicieux, car ils oppriment, marginalisent ou réduisent au silence d’autres perspectives. Les penseurs postmodernes insistent également sur le fait que tous, ou presque tous, les aspects de la psychologie humaine sont socialement construits (constructivisme). En revanche, pour ses critiques, le postmodernisme peut se donner l’air d’une vision du monde libératrice, mais il s’agit en fait d’une subversion idéologique et linguistique ; pour le sociologue et philosophe Shmuel Trigano (Petit manuel de postmodernisme illustré, Éditions Intervalles, 2022), sous l’apparence d’un anti-pouvoir, de nouveaux pouvoirs émergent de manière incontrôlée. Pour lui, « le postmodernisme apparaît comme le discours dominant véhiculé et relayé par les médias, l’université, la sphère juridique et j’ajouterai, par sa nature et ses modes d’action, l’économie financiarisée ».
Historiquement, la première apparition du terme « postmoderne » semble remonter à 1870 : le peintre anglais John Watkins Chapman (1853-1903) l’utilise en référence à une nouvelle manière de peindre. D’autres auteurs utiliseront ce néologisme au début du XXe siècle. Le professeur de philosophie américain Charles Gray Shaw (Trends of Civilization and Culture, American Book, 1932) l’emploie pour la première fois en lien avec la science (l’esprit scientifique moderne a été créé par Newton, mais depuis le début du XXe siècle nous serions dans une période postmoderne, où la science s’intéresse aussi aux phénomènes psychologiques). L’historien anglais Arnold Joseph Toynbee (A study of History, Volume 5, Oxford University Press, 1939) l’adopte pour décrire un nouveau cycle dans l’histoire occidentale, commencé en 1875 et fait de troubles sociaux, de révolutions et de guerres. Il existe d’autre part ce que certains considèrent comme des précurseurs de la pensée postmoderne, dès le XIXe siècle (Nietzsche*).
Cependant le basculement de la modernité vers la postmodernité, au sens donné ici (un système politique dominant, qui définit une ère nouvelle), a lieu après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, ce qui n’est pas un hasard. En effet, les connaissances scientifiques et technologiques ont conduit au développement de technologies* de destruction massive pendant cette guerre (dont la bombe atomique), qui s’est poursuivi pendant la Guerre Froide et après. La Science et la Raison éclairée du « projet des Lumières » semblent avoir échoué dans leur projet de libération et de marche inéluctable vers le Progrès (avec une majuscule). Dans une démarche politique que l’on peut qualifier de « jeter le bébé avec l’eau du bain », le postmodernisme rejette ainsi la foi dans la raison, la science et la technologie en tant qu’instruments du progrès humain. Pour certains, la science et les technologies, même la raison, seraient en fait intrinsèquement destructrices et oppressives.
Les luttes de libération nationale du XXe siècle et la fin du colonialisme ont également contribué à la remise en cause du projet moderne, accusé entre autres d’être réducteur, car centré sur une vision occidentale et monoculturelle, à laquelle il faudrait préférer la diversité sous toutes ses formes.
Sous un angle philosophique, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le postmodernisme se définit comme une réaction contre les valeurs* développées par la civilisation occidentale pendant la période allant de la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles, jusqu’au milieu du XXe siècle. Le postmodernisme rejette en particulier les points de vue philosophiques généraux exposés par les Lumières du XVIIIe siècle, et qui furent plus tard tenus pour acquis. Le postmodernisme nie ainsi qu’il existe une réalité naturelle objective, indépendamment des êtres humains et de leurs pratiques sociales ou de leurs techniques d’étude de la matérialité. Cette réalité serait une construction conceptuelle de la pratique scientifique ou du langage, autrement dit liée à des traditions intellectuelles spécifiques (qui n’auraient pas vocation à être universelles). Il en irait de même de la raison et de la logique. Pour certains, il en découle que la Vérité n’existe pas, toute description et explication pouvant, en principe, être objectivement vraie ou fausse. Il n’y aurait pas de Vérité, mais seulement des affirmations de vérité (des prétentions).
Il s’agit pour la pensée postmoderne de rejeter le « cogito ergo sum » de René Descartes. Dans son Discours de la Méthode (1637), le philosophe cherche des méthodes sur lesquelles fonder le savoir et accéder aux vérités. Pour lui, l’une d’elles est de mettre volontairement en doute ses connaissances et ses opinions. Or, c’est le sujet, qui doute, et pour douter, il faut penser. Ainsi, si je doute, je pense, et si je pense, je suis. Dans cette dialectique, le doute méthodique devient une voie d’accès à la certitude. Descartes peut être considéré comme le fondateur de la philosophie moderne ; ni Kant, ni Spinoza, ni Husserl ne remettront en cause cette mise au centre du sujet pensant. En revanche, la démarche de Descartes « pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences » est évidemment à « déconstruire » pour les penseurs de la postmodernité.
Après cette phase de « déconstruction* » philosophique par les auteurs de la French Theory*, le postmodernisme est devenu vers la fin des années 1980, une forme d’injonction morale basée sur la vision binaire d’opprimés et d’oppresseurs. Insidieusement, il est devenu l’idéologie dominante des institutions européennes (Commission, Parlement, Conseil de l’Union européenne) et de certains gouvernants des États membres, dont la France. Nous sommes ainsi entrés dans l’ère postmoderne ou postmodernité. Pour n’aborder ici que les aspects géopolitiques, l’Europe a voulu d’abord, et cela est compréhensible, prévenir de nouvelles guerres, génocides, ou totalitarismes. Ses instruments pour prévenir ces oppressions sont des Grands Principes, dont la Démocratie, les Droits de l’Homme, l’État de Droit, alliés à l’économie de marché. (les majuscules sont utilisées ici pour mettre en lumière la sacralisation de ces principes). Cependant, la démarche est devenue peu à peu idéologique à partir des années 1970/1980 : éviter coûte que coûte tout « tragique », y compris en renonçant à une ambition de puissance « impériale » et en affaiblissant les Etats-Nations (considérés comme des oppresseurs et des fauteurs de guerre). Aveuglée par cette idéologie, l’Europe se trouve régulièrement sidérée par l’attitude de puissance agressive de certains dirigeants peu adeptes de ces Grands Principes (la Une de Libération titrant « L’impensable » au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie est significative de ce point de vue…).
Poussée par l’écologie* politique, cette idéologie du « sans tragique » a été étendue aux risques technologiques (les technologies* sont vues comme de nouveaux oppresseurs en puissance, pour l’environnement et la santé). De nouveaux Grands Principes ont été inventés : le Principe de Précaution (voir l’entrée « zéro risque* ») et ce que l’on peut appeler le Principe de Participation (voir l’entrée « valeurs* ») ou d’Inclusion*.
Il est également possible de définir le postmodernisme comme une nouvelle mutation du « progressisme ». Son premier sens (dans l’ère moderne) a été un « grand récit » qui confère à l’Histoire un sens unique et infaillible, celui du « progrès de l’esprit humain » (Condorcet, et aussi Saint-Simon et Auguste Comte, par exemple). Ce sens, transformé, sera utilisé par l’utopie politique marxiste du salut collectif par une société sans classe, qui donnera naissance aux dictatures communistes. La nouvelle mutation (postmoderne) est celle où, d’une part, l’on prêche le changement pour le changement (bougisme) et, d’autre part, où dans un cadre pourtant démocratique certains traits d’une tyrannie plus ou moins douce ont été conservés : en citant Pierre-André Taguieff (Les Contre-réactionnaires. Le Progressisme entre illusion et imposture, Denoël, 2007), « une redoutable machine à condamner, souiller et exclure s’est mise en place […] dans les sociétés démocratiques, où elle fonctionne à des fins particulières sous couvert d’engagement politique, moral ou social, et se pare des vertus supposées du militantisme* ». Toujours selon Taguieff, ce « progressisme » est caractérisé par l’imposition d’un modèle « multicommunautariste » et « l’instrumentalisation politique de l’antiracisme » et du tribunal des opinions* « au nom de mémoires identitaires à la fois rivales et mimétiques. Qui n’applaudit pas à la célébration de telle ou telle minorité transfigurée en victime […] est dénoncé comme portant atteinte à la “dignité” du groupe considéré, et traité en conséquence comme un ennemi de l’Humanité ». La même mutation postmoderne du « progressisme » concerne également le féminisme, où sa conception universaliste est aux prises avec un néo-féministe différentialiste ou intersectionnel (voir l’entrée « genre* »).
Il est aussi possible de considérer que ces dernières mutations du « progressisme » ne sont que des changements de degré : c’est-à-dire que le racialisme (voir l’entrée « systémique* ») était dans le fruit des mouvements antiracistes d’origine (voir Paul Yonnet, Voyage au centre du malaise français : l’antiracisme et le roman national, réédité par L’Artilleur, 2022) et que le constructiviste était déjà présent dans le féminisme de Simone de Beauvoir (« on ne nait pas femme, on le devient »). Quoi qu’il en soit, la bataille pour ou contre le postmodernisme clive manifestement le camp « progressiste », ce qu’illustre de manière forte et concise la phrase d’Alain Finkielkraut : « c’est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche ».
R. Relativisme
Il n’est pas rare qu’un protagoniste d’une affaire médiatisée présente ce qu’il appelle « ma vérité ». Cette forme d’expression ne semble choquer personne, car le relativisme est généralisé dans nos sociétés postmodernes* : relativisme esthétique (le beau serait un effet de mode), relativisme normatif (les normes seraient uniquement des conventions arbitraires résultant d’une culture particulière à un temps donné), relativisme culturel (toutes les cultures, toutes les civilisations « se valent »), relativisme cognitif (la science n’aurait pas de certitude en matière de compréhension du monde).
Le philosophe Jacques Carbou (La critique sociale de Raymond Ruyer, Éditions du Verbe Haut, 2021) explique que pour Karl Popper « le relativisme de certains philosophes provient de la confusion des idées de vérité et de certitude » (la vérité étant objective, la certitude subjective). Il rappelle aussi les critiques de Popper du relativisme historique (« pour lequel il n’y a pas de vérité objective, mais seulement des vérités bonnes pour telle ou telle époque ») et du relativisme sociologique (pour qui « il existe des vérités ou des sciences valables pour tel groupe ou telle classe, par exemple une science prolétarienne et une science bourgeoise »). Pour Popper (À la recherche d’un monde meilleur, Les Belles Lettres, 2011) « le relativisme est un des nombreux crimes perpétrés par les intellectuels. Il est une trahison à l’endroit de la raison, et de l’humanité ». Le sociologue Raymond Boudon (Le relativisme, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2008) distinguait « bon » et « mauvais » relativismes : le premier – éthique – favorisant le respect de l’Autre ; le deuxième – cognitif – engendrant une perte des repères, intellectuels et parfois même factuels.
Les intellectuels postmodernes récusent généralement les accusations de relativisme. Ainsi, le philosophe français Jacob Rogozinski dans une tribune publiée par Le Monde le 23 janvier 2022, défendant Jacques Derrida, affirme que « déconstruire l’universalisme* ne revient pas à sombrer dans le “relativisme”, mais à découvrir la pluralité peut-être irréductible des différentes prétentions à l’universalité et contribuer ainsi à une refondation de l’universel qui ne surplomberait plus les singularités ». Cette phrase illustre le fait que le relativisme postmoderne peut être nié, car il est souvent moins synonyme de tout se vaut qu’un déni des certitudes absolues (il n’y aurait que des « prétentions » de vérité) : l’important n’étant plus La Vérité, mais des « singularités » mises à la mode (et donc fluctuantes) sous couvert de « pluralité ».
Une des premières charges contre le relativisme dans le milieu universitaire et la société en général aux États-Unis est venue du philosophe américain Allan Bloom (The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students, Simon & Schuster, 1987). Bloom critique « l’ouverture » affichée qui sape la pensée critique et élimine le « point de vue » qui définit les cultures. Selon lui, cette ouverture conduit paradoxalement à une grande fermeture, ce que le wokisme* a confirmé.
Pour la doxa postmoderne, toute question scientifique devrait être traitée en intégrant les sciences humaines (notamment la sociologie), ainsi que l’avis des « parties prenantes » (voir l’entrée « valeurs* »). Le problème étant que « la sociologie » est ici monopolisée par les science and technology studies et des courants proches (voir les entrées « querelle* » et « x-studies »), constructivistes et relativistes, qui ont remis en cause les idéaux universalistes de la connaissance scientifique.
Dans son livre Contre la méthode (1975), le philosophe des sciences américain Paul Feyerabend (1924-1994) prétend que le progrès des connaissances scientifiques n’est engendré par aucune règle méthodologique utile ou universelle. Pour son « anarchisme épistémologique », « anything goes » (tout est bon). Pourtant, la science s’efforce d’approcher les vérités universelles, en utilisant les observations, les mesures et les expérimentations rigoureuses, et le monde est formé d’objets gouvernés par des lois physiques qui existaient avant que notre connaissance ne les découvre. Progressivement, pendant des siècles, cette démarche scientifique s’est construite et la Raison s’est opposée (souvent difficilement) à la pensée magique (Voir Nayla Farouki, La Raison au risque de la pensée magique, revue Science et pseudo-sciences, 2013).
Faut-il pour autant récuser d’autres savoirs ? Non bien sûr, si ces derniers sont basés sur le sens commun et organisent la vie sociale de manière satisfaisante. Et s’ils ne viennent pas délégitimer les savoirs scientifiques. Le cas du « savoir traditionnel maori » en Nouvelle-Zélande est intéressant de ce point de vue. La pensée postmoderne y a déjà imposé la logique de projets participatifs du savoir autochtone dans les savoirs scientifiques, et l’enseignement de la culture maori (et ses mythes et son créationnisme) à égalité avec la science dans les facultés. La protestation de sept universitaires d’Auckland dans un journal local en juillet 2021 a été condamnée par la Direction de leur Université et par la Royal Society de Nouvelle-Zélande (l’équivalent d’une Académie des Sciences). Dans un communiqué, cette dernière affirme qu’elle « défend fermement la valeur de la connaissance maori » et dans une vision typiquement postmoderne ajoute qu’elle « rejette cette définition étroite et dépassée de la science » (traductions). Cette Royal Society avait également ouvert une enquête disciplinaire contre certains protestataires, mais devant les polémiques, elle a finalement innocenté les accusés en mars 2022.
Les illustrations de la soumission des organismes scientifiques au relativisme abondent. Par exemple, dans un dossier du magazine de l’INSERM de septembre-octobre 2014, intitulé « Téléphones portables. De vrais risques ? », un scientifique de l’ANSES rappelle qu’« il n’y a aucune preuve que les radiofréquences des téléphones portables aient un effet sur la santé », et une chercheuse le confirme sur la base d’études épidémiologiques (tout en nuançant pour les utilisateurs intensifs de téléphone, sans que l’on puisse établir de lien de causalité avec les ondes). En revanche, sur la première page du dossier, un militant d’une association anti-ondes décrète lui que « pour nous, le débat est tranché depuis longtemps. Le portable est dangereux », et par un étonnant retournement du réel, accuse l’ANSES de rendre « un avis très politique ». Illustrant encore davantage le relativisme postmoderne (pour qui la science est une opinion comme une autre) dans lequel baigne ce dossier, la rubrique est intitulée « opinions »…
Illustration : Image par Melissa de Pixabay
Autre lecture
Quatorze ouvrages à offrir pour ne pas céder au catastrophisme
Dix ouvrages antidotes pour passer l’été sans succomber à la collapsologie